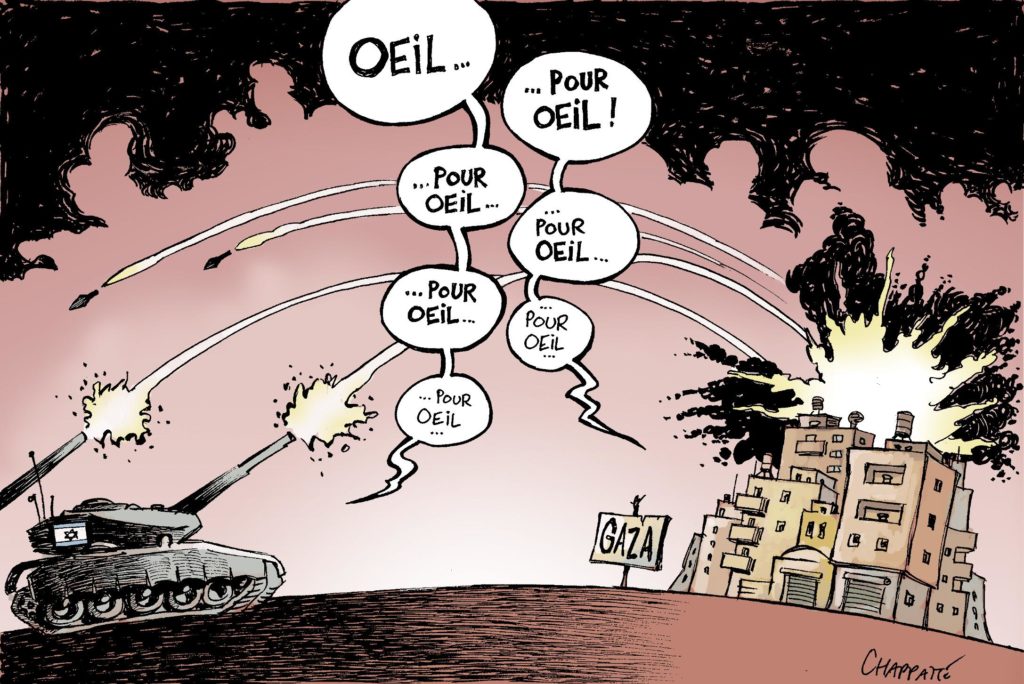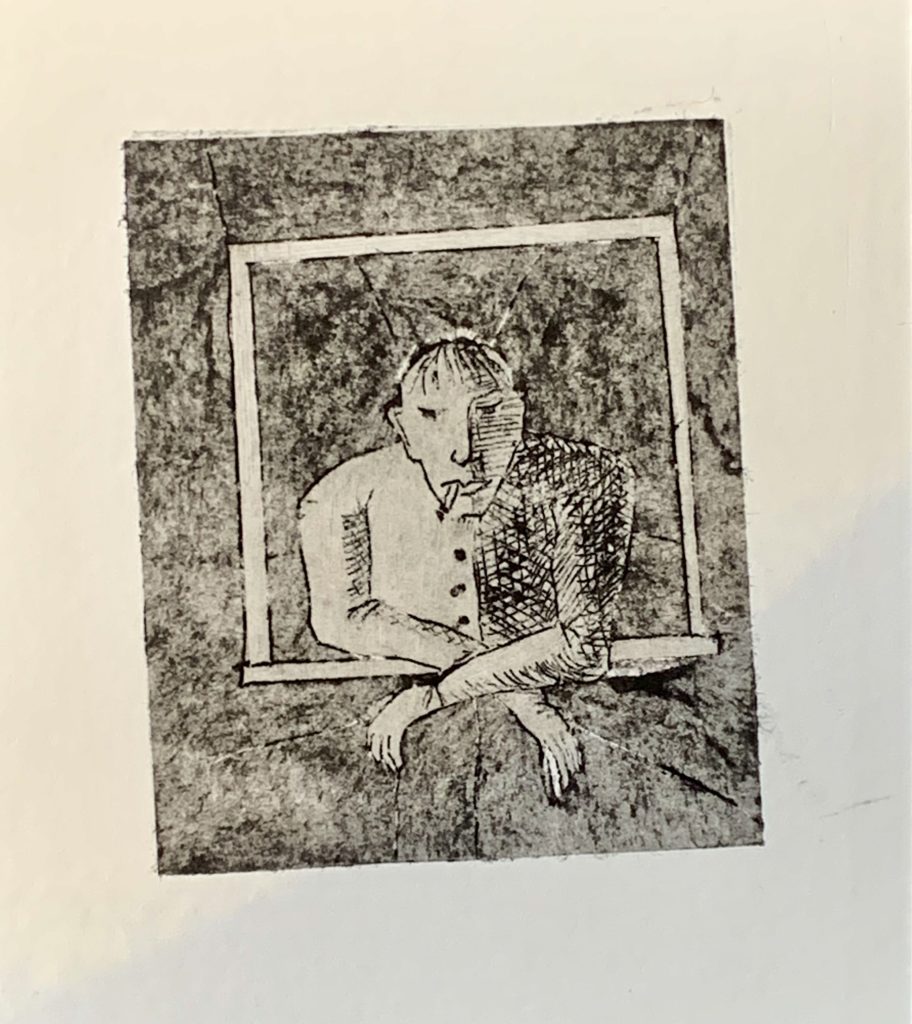
On revient sur l’affaire des salades de Joël Dicker. Isabelle Falconnier livre son opinion dans Le Temps. Selon elle, si L’Animal au rayon légumes des supermarchés permet de toucher un lecteur de plus, c’est déjà une petite victoire.
Imaginez le gars qui n’aurait jamais ouvert un bouquin de sa vie, qui penserait qu’Hercule est un poireau ou confondrait Bouillon de culture et soupe légère, que ce gars, par un heureux hasard consommateur, choisissant un cucurbitacée à l’étal d’un géant de l’alimentation, tombe en extase devant le petit Dicker illustré, le ramène chez lui et le cuit aux p’tits oignons. Et un lecteur de plus, un!
Je pense sincèrement qu’elle se trompe.
Un lecteur de Dicker, n’est pas (nécessairement) un lecteur de gagné à la cause littéraire. Dit-on d’un bouffeur de burger au MacDo du coin qu’il devient adepte des sapidités gastronomiques?
On n’apprend pas le goût des choses et du monde dans les cuisines des fast-foods.
Prenez un salon, une foire aux livres comme il en existe des dizaines. Approchez-vous de la cohorte en attente impatiente d’une dédicace de Joël Dicker. Tentez de proposer la lecture d’une autrice ou d’auteur qui attend le chaland dans le même salon, à quelques pas de là, il suffirait de peu pour le rencontrer, ouvrir son livre et, qui sait, découvrir quelque de frais, de neuf, de surprenant… or c’est dans les queues interminables de lectrices et de lecteurs de Dicker que les « ça ne m’intéresse pas » fusent le plus souvent. Vous ne vouliez rien vendre, à peine un instant de lecture, un petit cadeau entre quatre yeux et une oreille.
Expérience faite. Plusieurs fois.
Je ne crois pas que des livres comme ceux de Dicker ouvrent à d’autres lectures, attisent une soif de se plonger dans d’autres mondes, d’affronter des plumes plus complexes, de gravir des sommets inattendus. Au contraire. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils créent cette sensation rassurante que le « sujet, verbe, complément », associé à une construction habile, un suspens de série télévisée, que tout cela nous remplit.
Là où Isabelle Falconnier a raison, c’est lorsqu’elle écrit que « notre seule question (…) devrait être: comment rendre le livre accessible et désirable? » Sur ce terrain-là, je la rejoins entièrement. Là où sont les gens? D’accord. Dans un supermarché? Pourquoi pas.
Mais ce ne sera pas avec un navet sympathique. On pourrait peut-être inventer de jolies salades en couleurs. Au fond d’un beau jardin potager, par exemple.