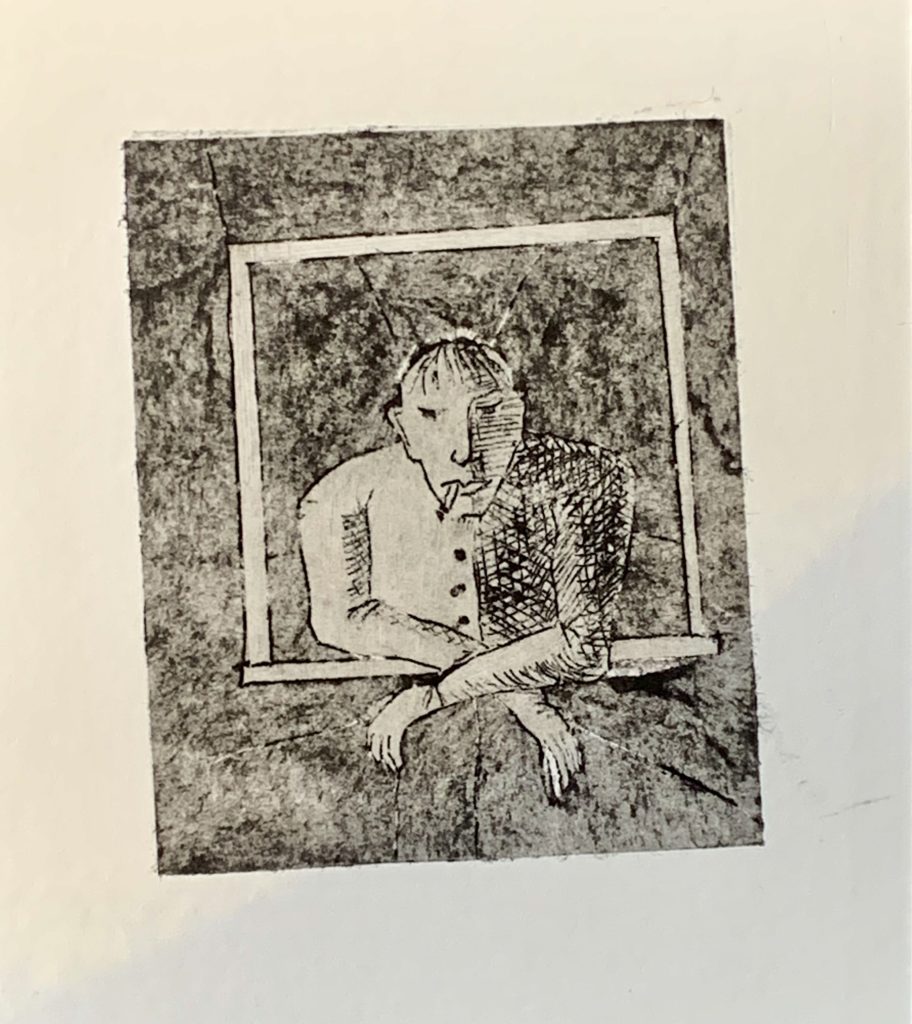Le RN n’est pas au pouvoir. Mais, si rien ne change, il le sera dans trois ans. Son enracinement croît à chaque scrutin. Là, il a fait trois fois plus de voix qu’en 2022.
Le mal profond dont souffre la politique française prend racine dans l’absence totale de culture du dialogue. Le constat est alarmant. La société française est fracturée, meurtrie et inégalitaire. Cette réalité devrait encourager une réflexion collective et des débats constructifs. Débattre, dans le sens qu’Etienne Klein donnait récemment: se parler pour ne pas se battre. Et écouter.
Au contraire, chaque prise de parole renforce les clivages et exacerbe les tensions. On l’a vu dimanche soir. Raphaël Glucksman relevait l’effort accompli lors de ce 2ème tour lorsqu’il s’agissait de voter pour un.e candidat.e parfois éloigné.e de ses convictions propres pour faire barrage au RN. Seul, il en appelait au dialogue (« il faudra parler, parler, se parler encore ») pour apprendre à gouverner ensemble. On a répondu « naïveté », et on a préféré l’invective.
Cette polarisation réduit l’espace politique à une bataille rangée, où l’objectif n’est plus de construire ensemble mais de vaincre l’adversaire à tout prix. Tous les coups sont permis. L’extrême-droite, avec ses discours clivants, trouve un terreau fertile dans cette atmosphère de défiance et d’affrontement. Elle s’en nourrit. Sa croissance est symptomatique de l’absence de dialogue. En jouant sur les peurs et les frustrations, elle capte un électorat désabusé, lassé de ne pas être entendu. Le reste de la classe politique peine à proposer des solutions qui rassemblent et se cantonne à une opposition stérile.
Mais pourquoi le dialogue est-il si difficile en France ? Peut-être parce que la politique est encore généralement perçue comme un lieu de confrontation plutôt que de coopération. Le système électoral, qui favorise les majorités au détriment des compromis, n’encourage pas les coalitions et les discussions transpartisanes. De plus, la culture politique française, marquée par une tradition centralisatrice et jacobine, laisse peu de place à la diversité des voix et des opinions. Et la réthorique est un art de combat. Le compromis est perçu comme une faiblesse, non comme un chemin à parcourir ensemble.
Le problème n’est pas seulement une question institutionnelle, elle est aussi culturelle. Les médias utilisent l’affrontement verbal comme un jeu du cirque, la controverse avant la mise à mort symbolique, une polémique est plus « vendeuse » qu’une discussion de fond. Et les réseaux sociaux amplifient. Dans ce contexte, imaginer un débat apaisé est, au mieux illusoire, au pire naïf.
Il est pourtant urgent de réinventer la culture politique française. Cela passe par une valorisation du dialogue et de l’écoute. Avec une société appelée à participer activement à la vie commune, aux choix fondamentaux, aux règles partagées, à travers des dispositifs de démocratie participative, des consultations citoyennes et des débats publics. Partout. Et les élus pourraient apprendre à sortir de leur logique partisane pour construire des ponts humains.
Et si l’on tentait réellement de former les citoyens à l’art du dialogue et du débat, en leur apprenant à écouter, à argumenter et à respecter les opinions divergentes? À l’école, dans les entreprises, dans les médias. Parce qu’une éducation au dialogue est essentielle à la construction d’une société plus inclusive et plus solidaire.
Pour surmonter les fractures et les inégalités qui meurtrissent quotidiennement la société française, la piste est là. Développer une culture du dialogue. Elle est la condition sine qua non pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions et donner un vrai corps à l’idéal républicain de liberté, d’égalité et de fraternité, bien au-delà du slogan sans âme qu’il est devenu.
Faire du consensus et du compromis la règle du jeu. Illusoire? Naïf? En fait, c’est cela que l’on n’a jamais essayé.