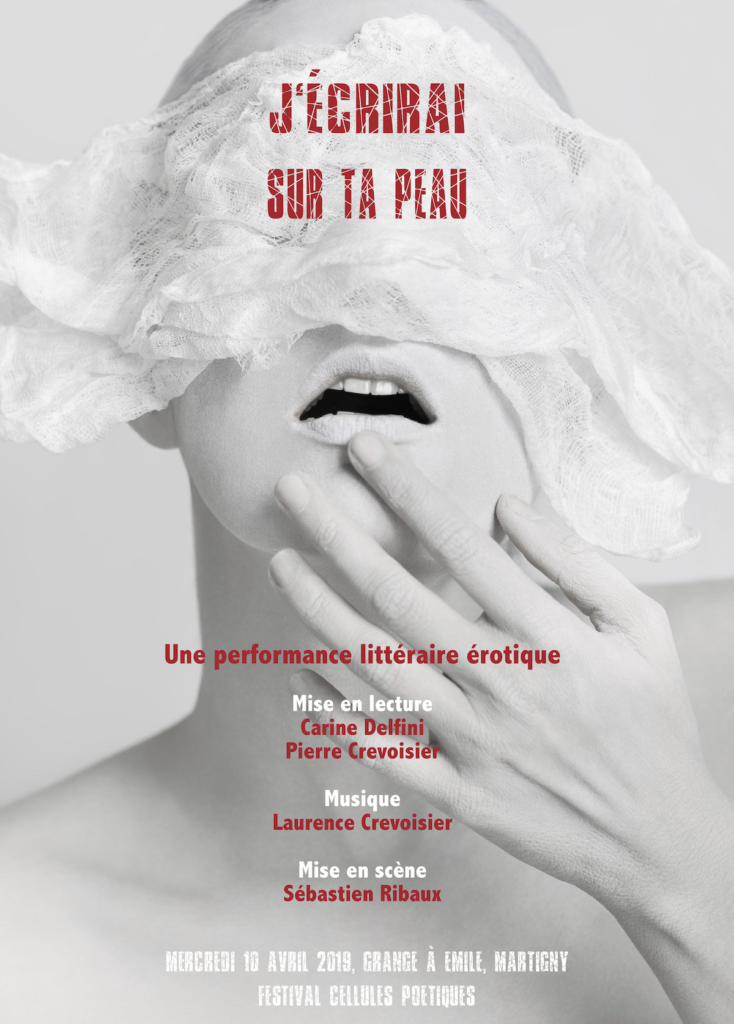Faut-il ajouter des mots aux mots, du bruit au bruit? Ce que je pourrais dire au sujet de la guerre entre Israël et le Hamas serait-il autre chose que ça? En tous les cas, je ne le ferai pas sous la forme d’une commentaire lapidaire sur les réseaux sociaux, tant ces espaces constituent la négation même du débat public. Inutile.
Mais peut-on simplement se taire, détourner la tête, se distraire, ne pas s’impliquer, passer son chemin, traire ses vaches quotidiennes en se disant que le monde peut exploser sans nous? Pas mieux.
Dès lors, comment le faire?
Dire d’abord que ce qui s’est passé samedi dernier a profondément ébranlé mon humanité.
Je lis les propos très juste de Raphaël Glucksmann – parmi d’autres – qui dit en premier lieu que « tirer sur des civils israéliens désarmés, kidnapper des enfants et des vieillards, exhiber des corps de femmes mortes comme des trophées, ce n’est pas un acte de résistance, c’est une attaque terroriste ». En même temps, il dit aussi que le gouvernement de Benjamin Netanyahu, par sa politique du pire, porte une lourde responsabilité, que les droits des Palestiniens sont bafoués depuis longtemps et qu’il n’y aura pas de paix sans solution politique, sans un État palestinien.
Ce qui est extraordinaire, c’est de lire ensuite qu’une telle réflexion est un « piège », que la recherche qui consiste à poser clairement tous les éléments du débat, c’est « mettre dos à dos deux comportements », c’est « s’engager sur la pente glissante de la fin justifie les moyens » et que le seul discours audible, la « seule chose qui mérite d’être dite (est) la condamnation sans équivoque » de l’acte terroriste.
Depuis quand pourrait-on se passer d’une jambe pour marcher? Car l’enjeu est là, au moment du retour dans la nuit barbare, il est de répondre à la question de savoir comment on fait pour avancer…
Notez que, s’agissant du Proche-Orient, la notion de « tous les éléments du débat » est toujours sujettes à caution, à oubli, à partialité. Les couches de l’histoire sont si anciennes, si complexes, si imbriquées les unes dans les autres, qu’une réflexion, aussi équilibrée soit-elle, aura toujours un défaut et qu’elle prêtera le flanc à la critique.
Aucune cause ne légitime l’horreur. Jamais.
Le Hamas, comme son allié iranien, se foutent totalement de l’existence des Palestiniens, femmes, hommes et enfants, qui crèvent maintenant, conséquences attendues de leurs actes, sous les bombardements israéliens. Leur calcul est celui du chaos absolu.
En même temps, écoutons une voix comme celle de Gideon Levy, journaliste israélien respecté (pas par tout le monde, mais on peut difficilement l’accuser d’antisémitisme) qui dit « nous payons le prix de la mise en cage de deux millions de personnes ». Comment faire l’économie de cette réalité-là? Parce que ce ne serait pas le moment de tergiverser alors que la maison brûle? Parce qu’une seule voie ne serait acceptable aujourd’hui, celle de l’éradication du Hamas? Une seule voix, celle qui appelle à se rassembler autour d’elle pour y parvenir, Netanyahu et un gouvernement dont le calcul est le pourrissement absolu?
Adopter cette position, c’est courir le risque d’être considéré comme l’idiot utile. Comme on qualifie aujourd’hui celles et ceux qui condamnent clairement la barbarie du Hamas en évoquant aussi la responsabilité de la politique d’occupation et de colonisation.
Dire l’un et l’autre, ce n’est pas dire « oui, mais… », ni jouer à un Ponce-Pilate qui ne veut pas se salir le manteau, ce n’est pas « tirer sur l’ambulance », encore moins justifier la barbarie.
Netanyahu n’est pas un brancardier derrière lequel l’humanité peut se rassembler. Il est – si ce n’est une des racines, car les racines du mal sont plus profondes – l’un des pyromanes.
Le Hamas n’est pas le peuple palestinien. Il est geôlier de Gaza et de deux millions de Palestiniens. Il en sera peut-être aujourd’hui le fossoyeur.
Faisons que cela n’advienne pas.
Une amie relevait ce matin les paroles de Delphine Horvilleur, écrivaine et femme rabbin et je transmets l’esprit, non la lettre : « Demain, le défi sera de trouver la part d’humanité qui existe toujours chez l’autre au coeur même de toute l’inhumanité qu’il peut porter”.