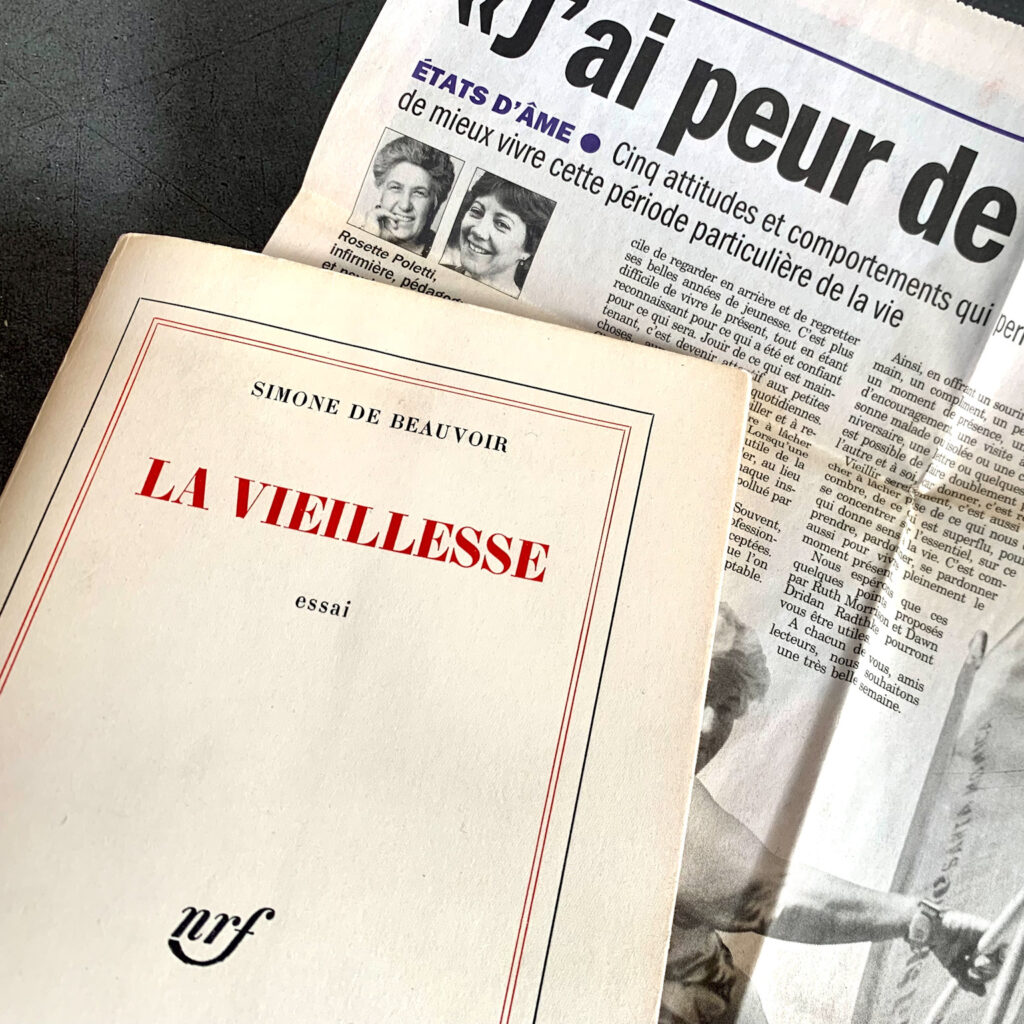Lorsqu’on n’a rien à dire, mais que le jeu social des réseaux connectés nous presse de dire quand même, les choses sont « magnifiques ». Vous avez remarqué ça, vous ? Les photos de l’un sont « magnifiques », les peintures de l’autre sont « magnifiques », les entrechats de la troisième sont « magnifiques » – les petits chats aussi – le coucher de soleil est « magnifique », la phrase sentencieuse et morale – dont on découvre à la fin qu’elle est empruntée à un autre moraliste, qui lui-même l’a empruntée à… – est encore « magnifique » (il y a aussi « tellement vrai »).
Gageons parfois qu’une franche admiration est présente et que ce mot « magnifique » en est l’expression la plus appropriée. Soit ! Mais reconnaissons que, la plupart du temps, le qualificatif, usé jusqu’à la corde, pourrait être remplacé par un grandiose, éclatant, brillant, bon, beau, parfait, extraordinaire, sublime, remarquable, supérieur, bellissime, admirable, précieux, rare, imposant…
Soit dit en passant, je pourrais étendre la réflexion aux classiques des expressions humaines dont l’usage mécanique me fait grimper aux murs des insignifiances : « sincères condoléances », « RIP », « bon anniversaire », « meilleurs vœux », « bonne année », « congrat »… mais restons au « magnifique ».
Et si l’on tentait autre chose ?
Nous pourrions choisir des termes en couleurs, des expressions qui révèlent nos émotions, cherchant plus étroitement à exprimer ce qui nous effleure : « tes œuvres contiennent une beauté sensible », « vos images me bouleversent », « tes paroles m’émeuvent », « votre geste me rend vivant » ? Et si, pour la rigole, nous inventions des mots qui n’existent pas, mais disent plus précisément l’humeur d’un instant : beaumouvant, séismatique, admirablime, tristoyeux, bouleverclatant!
Changer de registre de langage reviendrait à s’arrêter un instant, à respirer l’air du large, à écouter des silences, à penser trois secondes à ce que l’on écrit, dit, exprime.
Et à s’impliquer.